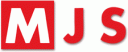Cet article, que j'ai écrit avec David Cayla, économiste et Paul Quiles, animateur comme moi du club Gauche Avenir, a été publié dans le quotidien Libération du 12 octobre 2009
"Les banques ont appris qu'elles pouvaient faire n'importe quoi"
Les banques vont mieux, les indices boursiers s’envolent, les bonus continuent à fleurir. Après avoir été au bord du collapsus, le secteur bancaire renoue avec les profits insolents d’il y a quelques années. Aux Etats-Unis, JP Morgan Chase annonce des bénéfices en hausse de 36% au second trimestre, tandis que ceux de Goldman Sachs ont bondi de 90% ! Même la convalescente Citigroup, renflouée à hauteur de 45 milliards de dollars par l'État fédéral américain, affiche un bénéfice net de 4,27 milliards de dollars au deuxième trimestre.
La France n’est pas épargnée par cette avalanche de profits. Il suffit de voir le redressement spectaculaire de la banque du génial Kerviel : en trois mois, la Société Générale est passée d’une perte de 278 millions d’euros au premier trimestre à un bénéfice de 309 millions. Quant à BNP Paribas, devenue première banque européenne après avoir avalé la belge Fortis, elle annonce plus de 3,1 milliards d’euros de profit pour les six premiers mois de l’année 2009.
Si ces profits avaient un lien avec l’activité de l’économie réelle, cela serait une bonne nouvelle. Or, avec un chômage qui augmente (le secteur privé américain a encore détruit plus de 260 000 emplois en septembre), les entreprises n’investissent pas et les ménages étranglés par la dette sont légion. Dans un tel contexte, où les pratiques bancaires n’ont pas changé, il est illusoire d’espérer, comme le fait le gouvernement, un redémarrage du crédit qui serait susceptible de relancer la production et la consommation.
Les banques n’investissent pas prioritairement dans l’économie réelle, parce que ce n’est pas assez rentable. D’où viennent alors leurs fabuleux profits ? Tout simplement de leurs activités spéculatives et de la hausse des marchés financiers. Avec la baisse des taux d’intérêt des banques centrales, les profits des activités de marché s’envolent, alors que la banque de détail reste au point mort. Retrouvant les bonnes vieilles méthodes de « l’effet levier », les salles de marché empruntent massivement pour maximiser leurs revenus à partir de produits à haut rendement, dont la complexité et l’absence de transparence n’ont rien à envier aux fameux crédits « subprimes ».
Les banques ont tiré au moins tiré une leçon de la crise. Elles savent à présent qu’aucun gouvernement ne laissera l’une d’entre elles faire faillite. L’épisode « Lehman Brothers » a fait plus de mal à ce pauvre Paulson (le secrétaire au trésor de George Bush) qu’il n’en a fait aux banques. Elles y ont même gagné. Les plus fortes ont profité des faillites des petites pour se renforcer, en rachetant à vil prix les actifs des « canards boiteux ». Le secteur bancaire en est sorti concentré, au point qu’une nouvelle faillite serait politiquement inenvisageable. Ainsi, fort de la garantie implicite des contribuables, le secteur bancaire peut spéculer sans risque et engranger des profits.
En France, l’État aurait pu, comme à Londres ou à Washington, procéder à la nationalisation totale ou partielle des banques qu’il a aidées. Il aurait pu, dans une logique d’optimisation des deniers publics, récupérer une partie de ces profits sous forme de dividendes. Il aurait pu, en revendant sa participation une fois la crise passée, dégager des plus-values, dont le montant s’exprime en milliards d’euros (12 milliards d’euros de plus-values potentielles pour les seules BNP Paribas et Société Générale). « L’État ne spécule pas », répond Christine Lagarde….qui oublie d’ajouter : « On laisse la spéculation aux banques » ! S’il avait vraiment voulu « refonder » le capitalisme financier comme il l’avait promis, Nicolas Sarkozy aurait pu faire participer pleinement l’Etat au capital des banques, en nommant des administrateurs publics et en exigeant la fin de cette spéculation mortifère.
On ne peut rester passif devant de tels scandales. Il faut aller à l’essentiel.
- L’essentiel, c’est d’abord d’arrêter cette folle logique, qui veut que, puisque la crise serait derrière nous, la spéculation effrénée peut reprendre « comme avant ».
- L’essentiel, c’est que l’État cesse de conforter un système rapace, dont l’activité normale consiste à détourner massivement la richesse créée dans l’économie réelle vers les casinos des marchés financiers.
- L’essentiel, c’est d’empêcher que se creuse le gouffre de la prochaine crise, en laissant les banques faire des profits qui ne correspondent pas à leur contribution réelle à l’économie.
Pour cela, il y a une solution simple: c’est d’imposer le plafonnement des profits bancaires par l’impôt, comme le propose Frédéric Lordon. Puisque les banques sont incapables de se réguler elles-mêmes, puisque le G20 n’a réussi à leur imposer qu’un encadrement cosmétique, il faut exiger que les profits bancaires retournent à l’économie réelle, en leur permettant de financer les dépenses de santé, d’éducation, de recherche, en donnant à l’État les moyens d’investir dans les transports, de mieux assurer la sécurité et de financer les services publics. C’est cela l’essentiel, si l’on veut vraiment que « demain ne soit pas comme avant ».
Les banques ont tiré au moins tiré une leçon de la crise. Elles savent à présent qu’aucun gouvernement ne laissera l’une d’entre elles faire faillite. L’épisode « Lehman Brothers » a fait plus de mal à ce pauvre Paulson (le secrétaire au trésor de George Bush) qu’il n’en a fait aux banques. Elles y ont même gagné. Les plus fortes ont profité des faillites des petites pour se renforcer, en rachetant à vil prix les actifs des « canards boiteux ». Le secteur bancaire en est sorti concentré, au point qu’une nouvelle faillite serait politiquement inenvisageable. Ainsi, fort de la garantie implicite des contribuables, le secteur bancaire peut spéculer sans risque et engranger des profits.
En France, l’État aurait pu, comme à Londres ou à Washington, procéder à la nationalisation totale ou partielle des banques qu’il a aidées. Il aurait pu, dans une logique d’optimisation des deniers publics, récupérer une partie de ces profits sous forme de dividendes. Il aurait pu, en revendant sa participation une fois la crise passée, dégager des plus-values, dont le montant s’exprime en milliards d’euros (12 milliards d’euros de plus-values potentielles pour les seules BNP Paribas et Société Générale). « L’État ne spécule pas », répond Christine Lagarde….qui oublie d’ajouter : « On laisse la spéculation aux banques » ! S’il avait vraiment voulu « refonder » le capitalisme financier comme il l’avait promis, Nicolas Sarkozy aurait pu faire participer pleinement l’Etat au capital des banques, en nommant des administrateurs publics et en exigeant la fin de cette spéculation mortifère.
On ne peut rester passif devant de tels scandales. Il faut aller à l’essentiel.
- L’essentiel, c’est d’abord d’arrêter cette folle logique, qui veut que, puisque la crise serait derrière nous, la spéculation effrénée peut reprendre « comme avant ».
- L’essentiel, c’est que l’État cesse de conforter un système rapace, dont l’activité normale consiste à détourner massivement la richesse créée dans l’économie réelle vers les casinos des marchés financiers.
- L’essentiel, c’est d’empêcher que se creuse le gouffre de la prochaine crise, en laissant les banques faire des profits qui ne correspondent pas à leur contribution réelle à l’économie.
Pour cela, il y a une solution simple: c’est d’imposer le plafonnement des profits bancaires par l’impôt, comme le propose Frédéric Lordon. Puisque les banques sont incapables de se réguler elles-mêmes, puisque le G20 n’a réussi à leur imposer qu’un encadrement cosmétique, il faut exiger que les profits bancaires retournent à l’économie réelle, en leur permettant de financer les dépenses de santé, d’éducation, de recherche, en donnant à l’État les moyens d’investir dans les transports, de mieux assurer la sécurité et de financer les services publics. C’est cela l’essentiel, si l’on veut vraiment que « demain ne soit pas comme avant ».